Vous êtes ici
Quel avenir pour l’Europe?

Le Groupe d’études sur l’Union européenne (SGEU) du Consortium européen de recherches en sciences politiques (ECPR), qui se réunit ces jours-ci en congrès à Sciences Po Paris, rassemble essentiellement des chercheurs en sciences sociales. Quelle est la vocation de cette association ?
Virginie Guiraudon1 : Au départ, au milieu des années 1990, nous nous sommes réunis avec quelques spécialistes de l’Union européenne, au moment où les sciences sociales se sont véritablement emparées de ce sujet. Depuis, nous nous sommes adossés à une structure plus importante, l’ECPR, plus tournée vers la science politique. Mais l’état d’esprit des débuts demeure : nous sommes convaincus que l’Union européenne et l’intégration européenne sont des objets d’étude interdisciplinaires. Les processus d’intégration européenne supposent bien sûr des formes politiques – les institutions de l’Union comme la Commission – mais celles-ci ne sont que la partie émergée de l’iceberg. D’autres dynamiques sont à l’œuvre, notamment sociales et économiques et qui affectent la vie quotidienne des citoyens européens. Le droit à la libre circulation des personnes, par exemple, qui pousse certains à bouger et d’autres pas, intéresse les sociologues qui étudient les politiques migratoires.
L’actualité européenne est pour le moins mouvementée, entre montée des populismes, Brexit et guerre commerciale avec les États-Unis. Les chercheurs portent-ils sur elle un regard singulier ?
V. G. : Nous allons nous interroger sur les conséquences possibles de tous ces phénomènes sur l’avenir de la construction européenne. Pas uniquement sous l’angle de l’avenir des institutions à Bruxelles, où la question serait : l’Union européenne va-t-elle survivre ? Mais pour tenter de comprendre en quoi cela risque d’affecter la vie des Européens : concrètement, que va-t-il arriver aux 3,5 millions de ressortissants de l’Union européenne qui vivent actuellement au Royaume Uni et aux 1,5 million de Britanniques qui vivent sur le sol européen ? On travaille avec des questionnaires très concrets – pourquoi ces gens sont-ils partis ? Comment cela s’est-il passé avant ? – pour lesquels les chercheurs disposent de méthodes et d’outils pertinents.
Votre objectif est-il d’apporter des réponses politiques à ces questions ?
V. G. : Notre but est scientifique : nous voulons faire des progrès dans la connaissance et la compréhension.
Mesurer le phénomène de l’euroscepticisme, cela ne peut ça se réduire à un sondage à un temps T. Il faut notamment avoir des bases de données longitudinales fiables, sachant que les données sont essentiellement stato-centrées. Cet exemple et celui de la libre circulation des personnes montrent que les études comparées des politiques nationales ne suffisent pas.
Il s’agit d’étudier des phénomènes transnationaux. Mais comment faire quand on ne dispose que de données nationales ? Mon collègue à Sciences Po, Ettore Recchi, a publié plusieurs études2 dont une longue enquête qu’il a réalisée avec un millier de personnes qui ont changé de pays au sein de l’Union européenne. Une de ses conclusions était que les Européens bougent beaucoup pour des raisons sentimentales et non pour le travail. Or, ces gens-là, on ne peut pas les trouver dans les statistiques nationales. La recherche permet ainsi d’envisager l’actualité à une autre échelle, dans une perspective plus large.
Vous avez parlé d’une approche interdisciplinaire : quelles disciplines des sciences sociales sont concernées ?
V. G. : Nous avons bien sûr des chercheurs en sciences politiques et des sociologues, mais aussi des anthropologues, des juristes ou encore des historiens. Ceux-ci sont très importants pour nous permettre notamment de retracer l’histoire transnationale, celle des réseaux qui, avant même les années 1950, se sont constitués en classes politiques européennes. On y découvre les parcours et les profils des gens qui se sont investis dans la construction européenne, assez différents des grandes figures que retiennent les manuels scolaires, comme Maurice Schumann ou Jean Monnet.
La rencontre de chercheurs venus d'horizons différents favorise aussi les débats de fond…
V. G. : Concernant le populisme, on se demande par exemple si on assiste aujourd’hui au retour des années 1930. Les historiens sont là pour nuancer les opinions et éviter les comparaisons hâtives – l’alliance du mouvement Cinq Étoiles et de la Ligue, en Italie, ça ne correspond pas nécessairement à un retour de Mussolini…
Il y a d’ailleurs ceux qui se placent dans une perspective non historienne et pour qui ce qui se passe aujourd’hui est un moment particulier, sans équivalent dans l’histoire du capitalisme.
J’ai tenu aussi à avoir des philosophes pour évoquer les questions autour de l’éthique politique, parce qu’on parle beaucoup des valeurs démocratiques européennes incluses dans les critères d’adhésion à l’Union, au moment où elles semblent remises en question par certains gouvernements de l’Est.
Face à toutes ces tensions internes, vos travaux sont-ils aussi une manière de prendre la défense de l’Europe ?
V. G. : Quand on dépasse la simple étude comparée des politiques nationales, on découvre un monde très éloigné de la vision des fondateurs, la vision « kantienne » pour parler comme les philosophes, celle d’un ensemble harmonieux où les peuples cohabitent dans une paix perpétuelle. La réalité est celle d’un monde de rapports de force et de luttes d’influence entre toutes sortes de groupes d’intérêts. En quelque sorte, plus on s’intéresse à l’Union européenne, plus on devient eurosceptique ! Mais en même temps, on comprend mieux aussi comment tout cela fonctionne et le simple fait de l’expliquer peut vous faire passer pour pro-européen. J’en ai fait moi-même l’expérience en 2005, lors du référendum français sur l’adoption d’une constitution européenne.



Il n’est donc pas question pour vous de prendre parti ?
V. G. : Nous avons l’ambition de travailler de manière détachée, avec un point de vue réaliste : contrairement peut-être aux générations précédentes de chercheurs, nous ne croyons plus à cette idée que les États vont finir par se dissoudre dans un super-État européen, capable de fédérer la fidélité et la loyauté des peuples. Mais, de fait, en tant que chercheurs, nous n’avons pas à prendre parti.
Ceci étant, il faut bien reconnaître que le vote du Brexit a été un moment très difficile pour les nombreux chercheurs et professeurs, anglais ou étrangers, qui travaillent au Royaume Uni. Sans être nécessairement pro-européens, beaucoup d’entre eux ont été traumatisés par le rejet des intellectuels qui a accompagné ce vote.
Leur ambition était seulement de dire aux gens : attention, les questions sur la libre circulation des personnes ou sur la sortie de l’Union européenne ne sont pas aussi simples que certains voudraient le faire croire. Ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus. Sans être des militants, nous avons la volonté d’être des chercheurs dans la cité et de participer à tous les grands débats publics.
Peut-on néanmoins poser la question frontalement : les chercheurs croient-ils que l’Union européenne a encore un avenir ?
V. G. : Je pense que, par profession, nous sommes plus conservateurs que les médias. Les discours catastrophiques, ce n’est pas pour nous. Si je devais résumer l’état d’esprit des chercheurs, je dirais quelque chose comme : oui, nous sommes en difficulté, mais ce n’est pas la première fois ! Il y a même dans le monde des études européennes un fort courant schumpétérien (du nom de l’économiste Joseph Schumpeter, qui défend la thèse de la destruction créatrice, NDLR) qui souligne qu’il y a toujours eu des crises dans l’histoire de l’Union européenne, mais que c’est grâce à ces crises que l’Europe se réinvente à chaque fois.
Malgré l’avalanche de menaces qui semble s’abattre sur elle aujourd’hui ?
V. G. : Il faut bien admettre que, ces deux dernières années, il s’est passé beaucoup de choses et, que chercheurs ou non, nous n’avons pas trente-six lectures possibles face à la montée de l’euroscepticisme. Néanmoins, on oublie peut-être un peu vite qu’au jour le jour, des décisions sont prises à Bruxelles, que le Parlement et le Conseil siègent, que la machine européenne tourne. On ne peut pas dire que tous ces gens font juste semblant !
Pour nous la question n’est donc pas : est-ce la fin de l’Europe ou non ? Nous voyons bien que les phénomènes sont plus progressifs. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas d’annoncer que tout va s’écrouler à Bruxelles, mais de comprendre ce qui change au sein de l’institution – par exemple, comment les mécanismes de décision se modifient quand on passe de douze puis quinze membres à vingt-sept. Beaucoup de choses ont évolué aussi depuis que la Commission a introduit un mode de gestion largement inspiré des méthodes de management, avec définition d’objectifs, audits de performance, etc. Le Parlement a également plus de pouvoir de décision, ce qui a donné une autre entrée ou « lobby » aux groupes d’intérêts… Notre rôle est d’observer comment se transforme ce qu’on ne considère plus comme une espèce de proto-État, mais comme un centre de décisions publiques. Pas de nous inscrire dans un débat sur la gravité de la crise.
Pour suivre les travaux du congrès :
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/en/ECPR-SGEU-2018/home/

























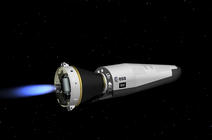















Commentaires
Connectez-vous, rejoignez la communauté
du journal CNRS