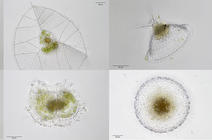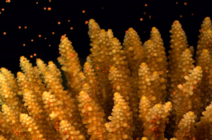Vous êtes ici
« L’urgence environnementale est bien plus pressante aujourd’hui »

Vous avez publié en 2016 un ouvrage intitulé La prochaine peste. L’épidémie actuelle était-elle prévisible ?
Serge Morand1 : L’apparition du virus SARS-CoV-2 était une possibilité parmi d’autres. Personne ne pouvait savoir que nous affronterions cette épidémie en particulier, mais toutes les conditions étaient réunies pour qu’une maladie infectieuse émergente de ce type se propage à grande vitesse sur la planète. La mondialisation s’est accélérée : les transports aériens n’ont jamais été aussi nombreux et fréquents – ils ont augmenté de 1 200 % depuis les années 1970 ! Le tourisme international de masse a explosé, y compris dans des pays comme la Chine. Cette accélération de la mondialisation explique que l’épidémie actuelle soit beaucoup plus répandue que celle du SRAS de 2002 par exemple.
Aujourd’hui, un agent pathogène peu virulent passe relativement inaperçu les premiers temps, et peut donc circuler très largement avant que l’on ne prenne conscience de sa gravité. Ça a été d’autant plus vrai, en l’occurrence, que le SARS-CoV-2 est hautement transmissible. Malheureusement, il me semble qu’un certain déni a prévalu depuis une vingtaine d’années. Nous et nos institutions avons du mal à remettre en cause notre manière d’occuper la planète et de circuler. C’est un peu comme une crise économique : on voit bien que la bulle grossit, grossit… Mais on fait semblant de ne pas le savoir.



Quelle autre politique appelez-vous de vos vœux ?
S.M. : L’émergence de ces épidémies est largement due à la part croissante qu’occupent les animaux domestiques et d’élevage dans notre environnement. Cela démultiplie les risques de transmission d’un virus d’une espèce à l’autre – humains inclus –, comme ça a été le cas pour les dernières grandes épidémies. D’autre part, cela entraîne une perte massive de biodiversité. La production de protéines végétales – soja, maïs… –, destinées à nourrir toutes ces bêtes, encourage la déforestation de régions telles que l’Amazonie par exemple. Une conséquence moins connue est que cela bouleverse des équilibres naturels et des mécanismes de résilience, qui nous permettaient de mieux faire face aux épidémies.
Partant, vous avez deux grandes possibilités, pour le dire de façon un peu schématique : soit vous considérez qu’il faut préserver la moitié de la planète de toute activité industrielle et agricole, et vous attribuez l’autre moitié à l’humanité ; soit vous pensez, comme moi, que nous faisons partie de cette biodiversité au même titre que tout être vivant, et vous devez imaginer de nouvelles façons d’appréhender et d’occuper les écosystèmes. Cela consiste par exemple à renoncer aux paysages unifonctionnels, tels que les champs agricoles ou certaines formes de pâturage industrialisé, pour revenir à des environnements non spécialisés, en mosaïque, permettant une multiplicité d’usages.



Faut-il réformer en priorité la politique agricole ?
S.M. : L’agriculture est au centre de nombreux enjeux : sécurité alimentaire, biodiversité, rapport de l’humanité à la nature… Il est impératif de revenir à des pratiques moins massives, moins mondialisées et plus territorialisées. Paradoxalement les institutions internationales semblent les plus en pointe sur ce point. La Commission européenne appelle depuis quelques mois à un « Green Deal » d’une manière qui me semble sincère. L’année dernière, même le Fonds monétaire international – pourtant peu suspect d’écologisme forcené… – a annoncé vouloir œuvrer contre le réchauffement climatique et en faveur de l’environnement.
Tout le monde est conscient de la nécessité de réformer la politique agricole commune. Il faut arrêter de subventionner en fonction de la production notamment, et prendre davantage en compte des critères écologiques : le service rendu par un agriculteur à son environnement, à l’économie locale… ou les économies d’eau qu’il a rendues possibles. Les chercheurs et spécialistes en sciences de l’environnement ont de nombreuses propositions à faire en ce sens. Mais le débat doit aussi impliquer les politiques, les citoyens, les acteurs de l’agro-alimentaire, etc.
Vous évoquez également les préconisations de la Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)…
SM : C’est un réseau d’experts de la biodiversité, analogue à celui du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Il a été imaginé par l’ONU en 2005 et officiellement créé en 2012. C’est l’IPBES qui nous a par exemple alertés, l’année dernière, sur le fait qu’un million d’espèces animales risquaient de disparaître à brève échéance. Jusqu’à présent, ce réseau s’est peu occupé de questions de santé ou des épidémies, mais c’est en train de changer. L’IPBES devait notamment lancer cette année une large étude – reportée à 2021, compte tenu du contexte… – sur l’impact de nos politiques agricoles et d’élevage.
Pensons aussi au rôle de l’Unesco qui apporte son soutien et son expérience des « réserves de biosphère ». Ce sont des zones jugées intéressantes pour étudier la biodiversité et imaginer des écosystèmes plus durables. L’Unesco est une institution parfaite pour démontrer concrètement l’importance de la biodiversité pour la santé, car elle a la spécificité d’œuvrer tant en faveur de la recherche scientifique que de l’éducation populaire.
De manière générale, ce type d’action s’inscrit dans le sillon de l’initiative One Health, imaginée par l’ONU au début des années 2000, mais réellement active depuis une petite dizaine d’années. L’idée est de créer une alliance entre des entités telles que l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des nations unies pour l’agriculture et l’alimentation, ou encore l’Organisation mondiale de la santé animale, afin de mieux faire face aux risques écologiques et épidémiologiques..
Y a-t-il une volonté plus marquée qu’il y a vingt ans, par exemple, chez les chercheurs en écologie, en sciences de l’environnement, de passer à l’action et de s’impliquer davantage en politique ?
S.M. : C’est très clair, ne serait-ce que parce que l’urgence environnementale est bien plus pressante aujourd’hui. Mais cela rejoint aussi des tendances de la recherche scientifique. Des domaines d’études, encore marginaux il y a vingt ou trente ans, occupent désormais une place de premier plan. Je pense par exemple à « l’écologie de la conservation » et de « la restauration ». Ce champ réfléchit aux meilleures définitions que l’on puisse donner d’espaces jugés caractéristiques – comme des fleuves, des villages, mais aussi d’anciennes mines par exemple. Un enjeu fort est de pouvoir étudier leurs interactions avec d’autres lieux et acteurs, et d’imaginer les meilleures façons de les préserver au titre de patrimoine bioculturel.
À un autre versant, tout ce qui relève de l’écologie dans le domaine de l’agriculture, de l’agronomie ou même de l’économie occupe une place croissante. Il est révélateur, par exemple, que l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ait récemment intégré un volet écologique dans ses disciplines de référence. Enfin du côté des sciences humaines, de l’anthropologie par exemple, les études sur les interactions entre l’humanité et la nature se sont démultipliées. Je pense par exemple aux travaux de l’écologue John Thompson et du géographe Raphaël Mathevet (Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive - CNRS) sur la « solidarité écologique », qui ont directement influencé la charte des parcs nationaux de France.



Vos propres projets de recherche comportent-ils une dimension politique ou opérationnelle ?
S.M. : J’ai eu la chance de pouvoir m’expatrier en Asie du Sud-Est et de développer des recherches en partenariat tant avec des organismes scientifiques que des décideurs politiques, des administrations ou encore des communautés locales. Nos recherches ont ainsi un impact direct sur la gestion des régions où nous travaillons. De plus, cette reconnaissance institutionnelle nous permet paradoxalement d’inscrire nos travaux dans la durée : ces derniers deviennent un tel maillon de la politique locale qu’ils ne peuvent plus être arrêtés du jour au lendemain, pour des raisons purement budgétaires par exemple.
L’année dernière en Thaïlande, nous avons lancé une grande enquête sur l’impact des pesticides à la demande de paysans, de représentants politiques et du ministère de la Santé. Nous avons bien précisé que nous ne donnerions pas de conseils pratiques en agronomie, mais que ce serait une recherche scientifique plus fondamentale. Pour autant, cela a été très bien accueilli. Plus de mille personnes ont donné leur sang afin de connaître leur exposition au glyphosate ; nous avons pu faire des prélèvements sur un grand nombre d’animaux sauvages, domestiques ou d’élevage, et faire une cartographie très précise de l’usage de pesticides. Cette recherche est encore en cours, elle intéresse tout autant les paysans thaïlandais que les décideurs publics. En France, l’écologie de la santé reste marginale et souvent mal comprise d’ailleurs. Mais la crise sanitaire que nous traversons pourrait, je l’espère, encourager son développement. ♦
À lire : Serge Morand, La prochaine Peste. Une histoire globale des maladies infectieuses, Fayard, 2016.
- 1. Directeur de recherche au CNRS, à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier (Isem - CNRS/Université de Montpellier/IRD/EPHE) et chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation/Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères).
Voir aussi
Auteur
Formé à l’École supérieure de journalisme de Lille, Fabien Trécourt travaille pour la presse magazine spécialisée et généraliste. Il a notamment collaboré aux titres Sciences humaines, Philosophie magazine, Cerveau & Psycho, Sciences et Avenir ou encore Ça m’intéresse.