Vous êtes ici
La fabrique du monument

Une statue, une église, un palais de la Renaissance italienne... Lorsque que l'on s'imagine des monuments, ces images nous viennent facilement à l'esprit. Pourtant, leurs formes sont bien plus diverses et leur réalité bien plus complexe. « Si la définition du monument historique est fondée sur un processus de sélection légal et administratif, d'autres paramètres permettent de qualifier un monument comme un objet auquel on a attribué différentes qualités, telles que la durabilité ou l'exemplarité », explique le géographe Pierre Sintès1, maître de conférences-HDR à l’université d’Aix-Marseille et membre du laboratoire Telemme2.
Une définition qui demeure fluide. C'est donc pour explorer ses nombreuses déclinaisons qu'a été lancé, il y a deux ans, le programme MonuMed – Monumentalisation et espaces urbains dans les Balkans et en Méditerranée3. Artistes et chercheurs en sciences humaines et sociales s'y sont rencontrés, sous la forme d'un collectif animé par Pierre Sintès et Alessandro Gallicchio, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes et membre associé du laboratoire Telemme. Deux notions principales y ont été étudiées.
D’une part, la monumentalité, c'est-à-dire la qualité qui fait d'un objet un monument (dimensions, proportions, styles...). Celle-ci n'est pas toujours rattachée à la matérialité du monument car son image peut subsister après sa destruction, et elle peut aussi venir s'incarner dans des objets qui n'étaient pas destinés au départ à devenir des monuments. D’autre part, la notion de monumentalisation, à savoir la mise en forme monumentale d'objets et de paysages urbains qui découlent bien souvent de l'expression du pouvoir politique en place. Explications.
Le retour du monument ?
« Le monument n'est pas un équipement urbain comme un autre, précise Pierre Sintès. Porteur et réservoir de sens, il peut être amené à incarner un nouveau message, à susciter de nouvelles pratiques ». Alessandro Gallicchio abonde en ce sens : « Chaque monument a son histoire symbolique ou politique qui l'inscrit dans des temporalités singulières ».
Et, si nous entrons dans une nouvelle ère, les monuments portent encore de multiples enjeux. Pourtant, de nombreux auteurs du XXe siècle, dont l'historien de l'architecture et de l'urbanisme Lewis Mumford, avaient théorisé la fin programmée des monuments, considérant que la modernité devait aboutir à l'émancipation des individus par rapport aux récits collectifs.
« Le mouvement moderniste a conçu le récit d'une ville rationaliste. En suivant l'exemple de Le Corbusier et des théoriciens du Congrès international d'architecture moderne (CIAM), il considérait que l'architecture devait être fonctionnelle dans sa planification et dans sa construction. Réunies dans la Charte d'Athènes (1933), les théories qui étaient à la base de cette nouvelle vision de l'urbanisme privilégiaient des solutions efficaces et adaptées à la ville du XXe siècle, c'est-à-dire à la "ville-machine". Chaque élément de ce nouvel ordre urbain devait respecter la fonction pour laquelle il avait été conçu », raconte Alessandro Gallicchio, avant de poursuivre : « Si les années 1960 ont, en effet, vu s'élaborer un mouvement d'anti-monumentalité, on remarque contre toute attente, depuis les années 1990, le retour du monument à une autre échelle ».
Pour illustrer ces transformations, l'historien de l'art prend deux exemples : « Alors que la statue équestre de Côme Ier de Médicis, symbole de la Renaissance florentine, était considérée, à l'époque moderne, comme une référence de l'incarnation du pouvoir, on observe que ce dernier se manifeste très différemment depuis quelques décennies. Conjointement à la mondialisation, il s'exprime à travers une dynamique de “skyline”, à savoir la silhouette urbaine dessinée par les monuments comme les gratte-ciels. L'architecture se substitue au fait monumental classique ».
C'est le cas, par exemple, de la nouvelle skyline du quartier Euromed de Marseille, ou encore, de manière plus iconique, de l'hôtel Burj Al Arab de Dubaï ou des grands musées (Guggenheim à Bilbao, Fondation Louis Vuitton à Paris), devenus de véritables emblèmes pour les villes qui les abritent. « L'architecte se positionne volontairement comme artiste et répond à la commande d'attractivité des villes en signant, avec des gestes souvent spectaculaires, les espaces urbains mondialisés », explique Alessandro Gallicchio.
Dans les Balkans, entre art contemporain politique et nationalisme kitsch
Alessandro Gallicchio a toutefois observé d'autres phénomènes dans l'espace balkanique. « Après la chute du communisme dans les années 1990, Tirana, la capitale albanaise, a été le lieu d'un turbo-urbanisme, avec une architecture qui tente de faire cohabiter politique, identité nationale, culture du folklore et technologie moderniste sur une période très brève », analyse le chercheur. Une transformation qui n'a pas été sans conséquence. Pollution, crise du logement, patrimoine détruit... Dans les années 2000, l'encombrement architectural des villes modernes albanaises est devenu un vrai problème de société. « Cette période a aussi été marquée par une figure inédite : celle d'Edi Rama, à la fois Premier ministre et artiste contemporain, qui a utilisé le langage mondialisé de l'art contemporain dans l'espace public, notamment autour du boulevard de la Nation et de la Patrie, axe principal de la ville », poursuit Alessandro Gallicchio.
Alors qu'une « marquise » en néon de l'artiste français Philippe Parreno orne l'entrée de la résidence du Premier ministre, un champignon géant multicolore, réalisé par Carsten Höller, trône dans le jardin. « On pourrait croire que ces figures sortent de la lutte entre pouvoir et contre-pouvoirs. Mais pas du tout. La population, à l'occasion de manifestations, détruit désormais des œuvres d'art contemporain qui incarnent ici le pouvoir pyramidal comme le faisait la statue équestre des siècles précédents », observe l'historien de l'art.

« On peut comparer, en miroir, la ville de Skopje, capitale de la République de Macédoine du nord, poursuit Pierre Sintès. Celle-ci connaît, depuis 2014, un énorme ravalement urbanistique à travers la multiplication de monuments aux messages ultra-nationalistes. Le VMRO, parti au pouvoir au moment de la réalisation du projet, a fait sortir de terre des monuments à l’aspect kitsch, dont une statue d'Alexandre Le Grand sur un piédestal de plus de dix mètres de haut, accompagnée par de la musique et des bruits de bataille. Cette monumentalité remplit les mêmes fonctions d'emprise du pouvoir qu'à Tirana, mais cette fois à travers la grammaire explicite du nationalisme. »



« Politiques de façade et façade du politique »
Les questions mémorielles se reflètent également dans les dynamiques qui entourent aujourd’hui les monuments. Ces derniers peuvent en effet devenir des lieux de tension, notamment avec l’émergence de groupes souhaitant faire valoir de nouveaux regards sur le passé. Un phénomène devenu bien visible en Occident ces dernières années, notamment aux États-Unis, où, après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une interpellation en mai 2020, de nombreux monuments liés au passé esclavagiste ont été pris à partie. « Le monument devient un enjeu sensible pour tous les groupes décoloniaux qui militent pour la justice mémorielle, se transformant parfois en véritable incarnation du combat pour la reconnaissance des droits et de l'égalité », analyse le géographe. « Le monument, dans ses différentes dimensions, évoque donc à la fois la politique de façade et la façade du politique », fait remarquer Alessandro Gallicchio. Un objet multiforme, que les chercheurs et artistes du programme MonuMed ont déjà abordé à travers un séminaire, des journées d'études, des conférences, et trois périodes de résidence – une à la Fondation Camargo à Cassis (Bouches-du-Rhône), deux à la Villa Romana de Florence.
À Florence et à Marseille, l'art comme expérience
Ces temps forts ont abouti, en octobre et novembre 2019, toujours dans la capitale toscane, à l'exposition « Monumento (s)fatto4 » qui s'est construite autour de quelques axes majeurs. « À travers un travail immersif dans cette région italienne, les artistes Leonora Bisagno et Bruno Baltzer se sont intéressés aux carrières de marbre de Carrare et aux groupes anarchistes qui caractérisent cet espace. À la fois à la matière et au processus de fabrication du monument », précise Alessandro Gallicchio. Dans une autre salle, Nicolas Milhé a produit un chien en bronze qu’il a placé en dialogue avec plusieurs autres œuvres, afin de dévoiler les soubassements de la monumentalité statuaire classique. « Pour lui, on retrouve, derrière le monument, la violence et l'animalité du pouvoir dans sa dimension dissymétrique », explique Pierre Sintès.
Plus loin, dans les jardins de la Villa Romana, un pavillon de verre abritait un travail expérimental, mené par la politologue Sarah Sajn et la photographe Eva Sauer, sur l'espace monumental et la mémoire en Bosnie-Herzégovine. « Différentes voix s'y croisaient, dans une structure inédite où la sculpture devenait socle et où le spectateur prenait la place habituelle de la sculpture. Une fois installés, les visiteurs pouvaient notamment lire des témoignages de l'architecte Bogdan Bogdanović concernant l'urbicide à Sarajevo dans le contexte de la guerre des années 1990, lorsque la destruction urbaine avait pour objectif d'effacer le caractère identitaire de la ville », précise Alessandro Gallicchio.
Si les chercheurs considèrent l'exposition florentine comme une belle rampe de lancement pour le projet MonuMed, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. « Une autre exposition, de plus grande envergure, était programmée au Fonds régional d'art contemporain (Frac) de Marseille pour novembre 2021, avant que la pandémie ne vienne repousser cette échéance à une date ultérieure », annonce Pierre Sintès. « Pour ces projets à venir, nous continuerons de défendre l'art comme expérience, insiste Alessandro Gallichio. Car, par sa capacité à travailler d'une manière intuitive, l'artiste ajoute de l'inconnu et de l'imprévisible. Par conséquent, il déplace notre regard en questionnant des détails que l'on n'aurait jamais interrogés ». ♦
- 1. Président de l'association française Études sur les Balkans et directeur de publication de la revue Balkanologie.
- 2. Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée (CNRS/Aix-Marseille Université).
- 3. Le programme MonuMed est soutenu par la fondation A*midex d’Aix-Marseille Université et par le laboratoire Telemme. Il est composé d’artistes, d’historiens de l’art, de géographes, de politistes et d’anthropologues.
- 4. Suite à l'exposition, Alessandro Gallicchio et Pierre Sintès ont publié l'ouvrage Monument en mouvements, Gli Ori Editori contemporanei, 2020. Lien : http://www.gliori.it/scheda_libro.php?id=970. (préface en français et en italien).
Mots-clés
Partager cet article
Auteur
Spécialisé dans les thématiques liées aux religions, à la spiritualité et à l’histoire, Matthieu Sricot collabore à différents médias, dont Le Monde des Religions, La Vie, Sciences Humaines ou encore l’Inrees.


































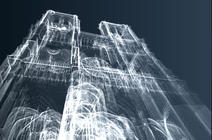
































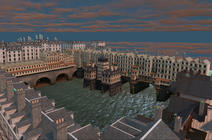



























Commentaires
Connectez-vous, rejoignez la communauté
du journal CNRS